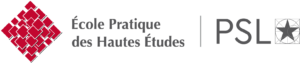Μάρτυρι μύθῳ. Poésie, histoire et société aux époques impériale et tardive.
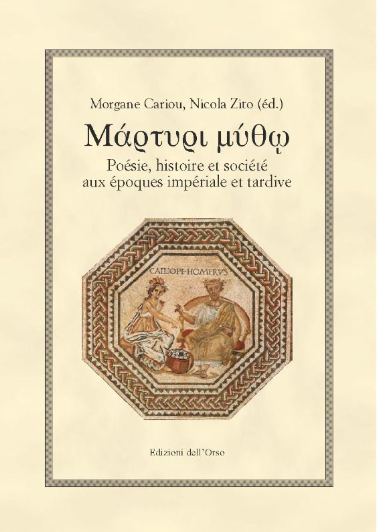 Μάρτυρι μύθῳ. Poésie, histoire et société aux époques impériale et tardive.
Μάρτυρι μύθῳ. Poésie, histoire et société aux époques impériale et tardive.
Actes du colloque international, Paris, Sorbonne Université, 8-10 septembre 2022
Collection : Hellenica / ISSN 1825-3490
574 pages
Alexandrie (it.), Edizioni dell’Orso, 2024
Ce volume collectif est consacré à la poésie composée en langue grecque sous l’Empire romain et durant l’Antiquité tardive, que sa transmission soit épigraphique, papyrologique ou codicologique, attachée à un nom ou anonyme. Il se propose de réfléchir aux questions de l’insertion des productions poétiques dans leur contexte historique et socio-culturel et de leur articulation avec les enjeux identitaires et artistiques contemporains. Pour cela, vingt-deux chapitres ont été réunis, qui tous cherchent à apporter des éléments de réponse aux problématiques suivantes : dans quelles mesures la poésie reflète-t-elle, directement ou indirectement, les grands questionnements et les grandes mutations des derniers siècles de l’Antiquité ? Quelles ont pu être ses fonctions dans la société ? Quels rapports les poètes entretenaient-ils à l’Empire, décliné sous ses problématiques du pouvoir, de l’espace, de l’altérité et du multiculturalisme et comment l’ont-ils représenté ? Plus particulièrement, que nous disent-ils de l’état de la science et des croyances, de l’éducation, de la cohabitation des cultures et des religions, de l’audience des philosophes à leur époque ? Par la façon dont elles abordent et évoquent la guerre, l’art, la littérature, les dieux, les hommes, la maladie, la nature et toutes sortes de realia, ces œuvres s’inscrivent dans leur temps, y compris – et peut-être surtout – lorsqu’elles en déforment ou en détournent la représentation. C’est ce regard que le poète porte sur ses contemporains, ce discours qu’il tient, en filigrane, sur son époque et sa culture, cette prise de position dans des controverses, en un mot ce témoignage que le présent ouvrage étudie sous l’égide de la formule μάρτυρι μύθῳ, chère à Nonnos de Panopolis.
Les articles réunis balaient à dessein un large spectre chronologique – du Principat d’Auguste à la fin de la période protobyzantine – et illustrent la diversité et la mutation des genres poétiques durant ces siècles. On trouvera ici des études d’inscriptions métriques tardives (G. Agosti), de la Description de Sainte Sophie de Paul le Silentiaire (R. Biagiucci), des Lithica “orphiques” (A. Broseta), des Halieutiques d’Oppien de Cilicie (M. Cariou), de l’In Bonum patricium de Georges de Pisidie (A. Cosme-Thomas), de la Tragédie de la goutte de Lucien de Samosate (M. Diarra), d’épigrammes satiriques du premier âge impérial (L. Floridi), de poèmes de circonstance de Dioscore d’Aphrodité (J.-L. Fournet), d’un remède analgésique versifié de Philon de Tarse (A. Guardasole), d’une énigmatique épigramme de Palladas (D. Iliev), des jeux érudits de l’Enlèvement d’Hélène (O. Karavas) et des représentations poétiques de l’espace dans ce même épyllion de Collouthos (E. Kneebone), de l’Ekphrasis de Jean de Gaza (D. Lauritzen), du poème astrologique de Dorothéos de Sidon (J. L. Lightfoot), d’épigrammes panégyriques dédiées à Justinien Ier (C. Minuto), de l’usage de la poésie dans l’apologétique chrétienne du IIe siècle (S. Morlet), d’épigrammes hagiographiques de Grégoire de Nazianze (Ó. Prieto Domínguez), d’un hymne chrétien de Synésios de Cyrène (H. Seng), des Cynégétiques du pseudo-Oppien (A. Vergados), du discours anti-noir de Nonnos de Panopolis dans les Dionysiaques (T. Whitmarsh), de poèmes isosyllabiques du corpus d’Ephrem le Grec (E. Zimbardi) et, enfin, du poème astrologique Des Initiatives de Maxime (N. Zito).